La rivière Bez scintille sous le soleil de fin d’après-midi. Des petits groupes de tous les âges se rafraîchissent dans le petit affluent de la Drôme. Peu à peu, les baigneurs empruntent le sentier qui longe la rivière et remonte jusqu’au village de Châtillon-en-Diois, à 15 km de Die, à deux pas du parc national du Vercors. Puis, des femmes maquillées et des hommes apprêtés viennent garnir le cortège. Tous se dirigent vers le bal qui a déjà commencé. Un son aigu de vièle à roue parvient aux oreilles et attire la foule jusqu’à la salle des fêtes.
À l’intérieur, la grande scène est décorée avec des outils agricoles et un épouvantail. Deux jeunes musiciennes annoncent : « Le prochain morceau est une bourrée à deux temps ». Sur le parquet, la plupart des 150 personnes ont compris le message. Chacun se positionne face à un partenaire. Les danseurs qui se retrouvent seuls lèvent la main pour former un duo. Tout le monde est prêt. Les cordes résonnent à nouveau, la foule se met en mouvement. Certains couples maîtrisent les pas à la perfection, d’autres font un peu n’importe quoi. Mais tout le monde s’en moque.
Il est 20 heures, en cette fin du mois de mai, pour la 13e édition du festival des Nuits du folk dioises. Les festivaliers sont arrivés de toute la France, de Suisse ou d’Italie. Pendant quatre soirs, entre 300 et 400 personnes vont danser jusqu’à 5 heures du matin.
Casser les clichés
Isabelle a avalé 500 kilomètres pour participer au festival. « La plupart des gens ne connaissent pas notre milieu, déplore-t-elle. Quand on leur parle de “folk” ou “trad”, ils s’imaginent qu’on va danser avec des sabots. » Cela fait trente ans que cette bibliothécaire du Cher fréquente le bal. Elle connaît la plupart des danses traditionnelles : le rondeau, la branle, le cercle circassien, la scottish, la polka, etc.
Plus récemment, elle s’est même lancée comme musicienne dans un trio. « Pour avoir le plaisir de faire danser les gens », glisse-t-elle entre deux chapelloises, une danse en cercle très chorégraphiée. Mickaël, Lyonnais de 50 ans, loue la convivialité du milieu. « J’ai longtemps fait de la salsa, c’était plus élitiste, davantage dans la drague et la séduction. Dans le folk, tout le monde danse avec tout le monde. On rencontre des gens de tous les âges, on se fait des amis, c’est pour cela qu’on revient. » Angélique, 39 ans, employée dans la production de fromage dans le Vercors, confirme : « J’ai découvert ce monde il y a quatre ans. Je suis venue et j’ai trouvé une communauté humaniste, un peu “bisounours”, sourit- elle. Le bal est devenu un ingrédient de ma vie. »
Un lieu de rencontre
Ce week-end-là, le site web Agenda Trad recense plus d’une soixantaine de bals aux quatre coins de la France, la plupart dans des communes rurales. Le sociologue Christophe Apprill, auteur de l’ouvrage Les Mondes du bal (Presses universitaires de Paris Nanterre, 2018), estime que le nombre de participants à ces événements se situe entre un et trois millions en France, « dont la majorité dans les bals folk et trad », précise-t-il. Mais il n’existe pas d’études statistiques sur le sujet.
« Nous n’avons pas de données précises, comme il en existe pour d’autres pratiques, car c’est ce qu’on appelle, en sociologie, une culture illégitime. Elle n’est pas valorisée par les élites. » Pourtant, jusqu’aux années 1970, en France, le bal est le premier lieu de formation des couples. « Si vous remontez dans votre généalogie, poursuit le chercheur, vous tomberez probablement sur des parents, des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui se sont rencontrés dans ce genre d’événements. C’est-à-dire que si vous êtes là, c’est parce que le bal était là. »

Les danses traditionnelles modernisées
Aujourd’hui, l’ambiance musette d’antan se réinvente. Dans le Diois, il règne une atmosphère alternative et « baba », tout le monde se tutoie à proximité du stand de repas végétariens. Les valses, comme tous les autres duos, sont volontiers dansées entre femmes et certains hommes portent des jupes longues. Les pas traditionnels sont agrémentés de variantes nouvelles, les styles musicaux se mélangent selon la créativité des compositeurs.
« Parfois, on ne sait plus si c’est une mazurka ou un zouk », s’amuse Patrick, un quadra venu de Genève. Résultat : depuis une quinzaine d’années, le public qui assiste à ces grands raouts s’est considérablement rajeuni. Des jeunes gens d’une vingtaine d’années se réapproprient la culture de leurs aïeux. Une des raisons de ce succès est qu’il est facile d’entrer dans la danse.

Osmose et transe de basse intensité
Éva, 27 ans, a suivi un ami aux Nuits du folk sans trop savoir de quoi il retournait. « Au début j’avais compris bal funk », s’amuse-t-elle. En quelques heures, elle est déjà conquise. « Comme les gens m’ont invitée à danser, je me suis jetée à l’eau. Cela crée une osmose, j’ai adoré. »
Jeanne, pétillante rousse en robe blanche de 31 ans, se rend au bal au moins une fois par mois, à la recherche de cette énergie. « Dans le fait de se toucher, d’établir une connexion corps à corps, je trouve qu’il y a une sorte de transgression, revendique-t-elle. Rencontrer des gens par le corps avant même de savoir leur prénom, c’est un sentiment fort. » Y aurait-il un aspect presque magique dans ces danses ?
« J’appelle cela une transe de basse intensité, abonde le sociologue Christophe Apprill, on rentre dans une sorte d’état de grâce, on ne sait plus très bien ce qu’on fait, on perd la notion du temps. On y rentre par la danse, par la musique, mais aussi par le contact. Le toucher est un sens que les anthropologues décrivent depuis longtemps comme un tabou dans notre société, on ne se prend pas dans les bras au bureau par exemple. Il y a dans le bal quelque chose qui rompt avec l’ordinaire. »
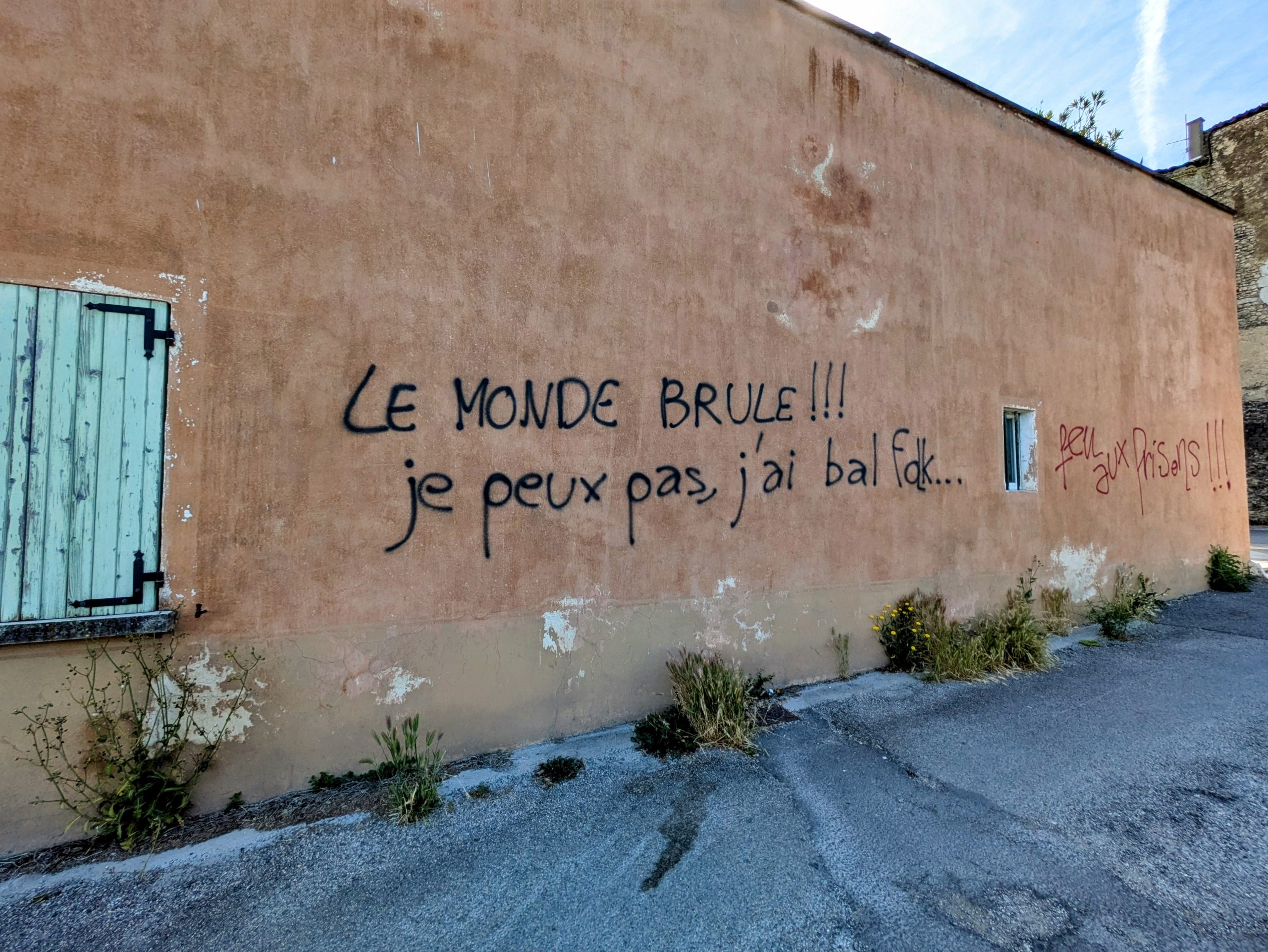
L’art de la débrouille
L’accès à la salle des fêtes coûte 27 euros par soir. Mais pour attirer de nouveaux publics, un parquet gratuit est installé juste à côté permettant de danser sur la musique. Pour Pierre-Étienne Bas, président de l’association Folk en Diois, organisatrice de l’événement, « c’est une manière d’attirer des curieux et d’ouvrir le milieu folk aux touristes, habitants néophytes ou randonneurs de passage ». Le festival fonctionne sans aide publique ou presque. L’association touche une petite subvention municipale qui correspond à 0,5 % du budget. « La mairie nous aide aussi en nous facilitant l’accès aux salles par exemple », précise Pierre-Étienne Bas. Le reste, c’est affaire de passion.
Il est plus de 3 heures du matin, des musiciens se sont installés sur la scène et font un bœuf, les danseurs dopés au jus de gingembre sont toujours là. Nombre d’entre eux fatiguent et ont mal aux jambes. Il est temps d’aller se coucher. Et puis, le petit son d’accordéon reprend et happe les plus épuisés. Encore une dernière danse.
