Croyez-vous au déclin des campagnes ?
Benoît Coquard : Il y a des milieux ruraux qui se repeuplent et connaissent un regain d’intérêt surtout après l’épidémie de Covid. Et d’autres campagnes qui se dépeuplent. Elles se situent dans les régions autrefois industrialisées qui ont perdu beaucoup d’emplois. Eloignées des grandes villes, elles ne profitent pas de l’attractivité des pôles notamment universitaires. Elles sont habitées par les classes populaires : des ouvriers, des employés, en lien avec beaucoup d’emplois dans l’industrie depuis la fin du XIXe siècle.
Dans ces classes sociales, les jeunes sont souvent les premiers de leur famille à faire des études supérieures, à la faveur de la massification scolaire depuis les années 1990. Et comme il y a peu de perspective d’emploi sur place, celles et ceux qui partent pour les études sont devenus plus nombreux.
Or moi je me suis intéressé à ceux qui restent. J’ai insisté là-dessus dans le titre de mon livre parce qu’il n’est pas simplement question de rester dans un endroit que beaucoup ont quitté, il s’agit aussi de s’accrocher, de perpétuer un style de vie ailleurs dévalorisé. J’ai tenté de rendre raison de ce phénomène en montrant pourquoi ça fonctionnait encore.
Les groupes d’amis que vous explorez
deviennent des espaces de sociabilité ?
Cette question est au cœur de mon travail. Les « bandes de potes » sont un signe des temps, au sens où elles ont pris une importance depuis la crise de l’emploi local. J’ai eu la chance dans mes recherches de suivre des gens sur une dizaine d’années. Parmi eux, trois ont trouvé un travail et ont formé leur couple via ces relations amicales-là qu’ils désignent comme leur « bande de potes » ou « clan ». Le signe du temps, c’était le rôle social joué par ces bandes de potes. Elles ne permettent pas juste de passer de bons moments amicaux ensemble. Elles servent aussi à la reproduction sociale.
Ces fonctions ont été tenues auparavant par des appartenances villageoises voire paroissiales, par aussi des employeurs paternalistes qui recrutaient de génération en génération la main-d’œuvre sur un même territoire. Ce socle n’existe plus. A la place, ce sont ces bandes de potes qui permettent de connaître des gens, de s’entraider, d’accéder à du travail, de se garantir certaines formes de réputation ou d’acquérir un capital symbolique.
LIRE AUSSI :
Mobilité en Haute-Loire : la solution provisoire du covoiturage
Mission locale rurale : un minibus pour avancer dans la vie
Regarder la jeunesse dans les yeux
Étude : la jeunesse rurale à la loupe
Entre ceux qui restent, vous relevez des divisions ?
Dans ces générations d’enfants d’ouvriers et ouvrières du textile, du bâtiment, j’ai observé une polarisation entre ceux qui sont appelés « les cassos », parce qu’ils se retrouvaient beaucoup plus isolés, vivaient plus des aides sociales et peinaient à entrer dans le marché local de l’emploi et les autres, les jeunes bien vus, qui avaient très tôt des enfants, une stabilité conjugale et se fréquentaient entre eux. Ceux-là concrétisaient des formes de réussite sociale qui ne seraient pas valorisantes ailleurs et qui dans ce contexte-là le sont.
Les grandes villes ne les attirent pas du tout ?
Paris et les grandes villes sont des modèles repoussoirs pour ceux qui restent. Pour eux, la vie là-bas est une forme « d’arnaque » : tout est y très cher, les logements y sont petits. Surtout ils jugent que leurs homologues structuraux, les ouvriers, les caissières, les femmes de ménages sont exclus du centre et disposent peu d’espace pour se valoriser alors que ce n’est pas le cas dans le bourg ou village où cette place est centrale.
Tout cela tient au fait qu’ils y trouvent les moyens de se valoriser, de prouver par exemple quand on est un homme qu’on est courageux ou qu’on sait tenir sa famille quand on est une femme. Même si les rôles sont très genrés et traditionnels, ils offrent un espace de reconnaissance à des territoires en déclin qui ne sont pas disputés par d’autres groupes sociaux. Ce ne sont pas des campagnes gentrifiées. Pour ceux qui restent, la périphérie, ce sont les grandes villes.
Que disent les bandes de pote de la vie en milieu rural ?
C’est que l’on ne se fréquente plus au hasard des gens du coin, il n’y a plus ce que les anthropologues appelaient « la communauté villageoise », l’idée d’appartenir à un village. C’est dans ce cadre-là qu’on avait des relations, qu’on occupait chacun sa fonction dans la société villageoise. Lorsque ceux qui restent disent qu’il y a les vrais potes sur qui compter, ceux de la bande de potes et les autres, « les Salut-ça-va », on se rend compte qu’il y a différents niveaux d’intensité des relations, de la confiance, de l’entraide et de concurrence sur le marché de l’emploi. Plus on est en concurrence avec des gens qui nous ressemblent, plus il y aura des stratégies dites en sociologie de dénigrement latéral. Cette concurrence se joue au niveau du travail et de la reconnaissance sociale.
Vous faites état dans votre livre d’un déplacement
de cette population après le Bac ?
Ce déplacement de population a été plus fort en proportion que l’exode rural dans ces régions-là. Ils ont perdu plus de populations parce que ceux qui partent ce sont des jeunes femmes. Il n’y a pas besoin d’être un grand démographe pour comprendre que quand il y a moins de femmes, il y a moins d’enfants qui se font.
J’avais commencé par étudier ces jeunes femmes-là. C’étaient mes amies d’enfances avec qui j’étais resté le plus proche. Dans ces milieux-là, on est enfants d’ouvriers et d’employés. Nos parents ne sont pas allés au lycée. Ils ont même arrêté l’école très tôt. Généralement il y en a un ou une par fratrie qui fait des études. C’est souvent une fille parce que les filles réussissent bien mieux à l’école que les garçons. Donc les filles partent. Et elles sont oubliées parce qu’elles sont des femmes. Dans le milieu de ceux qui restent on reconnaît davantage les hommes que les femmes.
Elles, elles me disaient : « Je ne vais pas revenir pour faire caissière avec Bac+ 4. » Mais elles n’avaient pas forcément planifié de rester en ville. Elles s’étaient fait prendre par le jeu scolaire. Elles étaient bonnes à l’école. Elles y sont allées. Et à moment donné pour x raison elles veulent revenir.
Vous relevez une inégalité dans les reconnaissances entre hommes et femmes ?
Quitter sa région rurale à 18 ans parce qu’on a eu le Bac est un phénomène commun à la plupart des espaces ruraux en raison de l’éloignement des grandes villes universitaires. Mais on revient dans les espaces ruraux dynamiques. Dans les ruralités dites attractives il y a des emplois qualifiés pour lesquels des formations adaptées sont mises en place. Actuellement on observe des ajustements pour la génération d’entre deux. Celle que j’ai suivie était la génération de la massification scolaire. On allait faire des études parce que c’était une nouvelle opportunité sans présager que le diplôme n’avait de valeur qu’en ville.
Maintenant il y a des diplômes qui ont de la valeur dans les campagnes industrielles. Paradoxalement aujourd’hui, si on est un enfant d’ouvrier qui reproduit le rapport de l’école de son père, on ne rentrera pas dans les usines pour la bonne raison qu’il faut avoir désormais un BTS pour manipuler les machines. Un minimum de formation est requis.
Quand vous interrogez les patrons de ces régions-là, ils assurent qu’ils ont du mal à recruter dans les emplois qualifiés : les gens diplômés ne veulent pas venir habiter là. Ils repartent très vite. Il y a un fort turn-over chez les cadres du privé et du public alors même que les filles du coin qui voudraient bien revenir n’ont pas les formations nécessaires pour les emplois demandés chez elles, là où elles voudraient vivre.
Ce décalage montre que depuis le début de leur formation ces femmes-là ont été happées par un contre-modèle qui ne leur a pas réussi parce que localement on n’a pas valorisé leur réussite sociale. Au village, personne ne comprend ce qu’elles font ni ce qu’elles sont devenues. On ne s’intéresse pas à elles.
Alors que ceux qui partent à l’armée ou qui s’engagent pour devenir pompiers professionnels ils ont leur portrait dans les journaux. Quand des années plus tard, ils reviennent au pays ils occupent le devant de la scène à tous les points de vue. Il y a des inégalités dans la reconnaissance sociale qui s’expriment bien au travers du parcours de ces jeunes femmes-là.
Vous ne dites pas jeunes ruraux mais ceux qui restent ? C’est la même chose ?
Pour moi ce n’est pas un objet de science en soi. les mots « jeunesse » et « ruralité » sont deux notions de sens commun. La jeunesse rurale est si multiple qu’il est compliqué de la penser ensemble. J’ai tendance à définir les gens par leurs conditions de vie et leur mode de vie plutôt que par le fait qu’ils soient biologiquement jeunes et qu’ils habitent dans ce qu’on appelle la ruralité au sens de l’Insee.
Je plaide pour une appréhension qui met les classes sociales au cœur de l’espace, c’est-à-dire de la géographie. Quand on grandit quelque part ça a du sens de dire : « J’ai grandi ici. » Parce qu’on a été élevé d’une certaine manière, on nous a mis dans la tête certaines aspirations plutôt que d’autres, on a opté pour telle voie dans sa vie, on a préféré se marier avec telle personne, on a choisi de construire sa maison de telle manière selon qui nous a entourés.
Et ce qui nous a entourés, c’est tel ou tel style de vie de gens autour de soi qui renvoie de manière générale à leur classe sociale. Alors c’est sûr qu’un ouvrier qui habite dans un centre-ville, il va aller moins à la chasse et à la pêche qu’un ouvrier rural. Mais ils vont se retrouver dans la manière d’élever leurs enfants.
Faire sa vie dans les campagnes en déclin
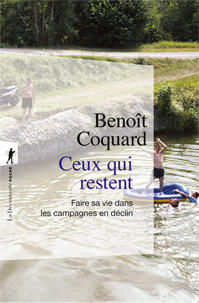 « Moi j’ai écrit contre les théories de la France périphérique, de la montée de l’individualisme dans la France éloignée des grandes villes qui sont les théories dominantes. Elles sont écrites à Paris par des gens qui ne mettent pas le pied dans le cœur des relations sociales de ces villages-là. »
« Moi j’ai écrit contre les théories de la France périphérique, de la montée de l’individualisme dans la France éloignée des grandes villes qui sont les théories dominantes. Elles sont écrites à Paris par des gens qui ne mettent pas le pied dans le cœur des relations sociales de ces villages-là. »
Pour donner de la visibilité à la jeunesse des classes populaires vivant en milieu rural, Benoît Coquard utilise la méthode d’enquête par immersion.
C’est de l’intérieur qu’il en décrit les sociabilités et qu’il dévoile la complexité des rapports sociaux. Entre autres enseignements soulignés, les personnes sont fières et sûres de leur style de vie.
Ceux qui restent : faire sa vie dans les campagnes en déclin a été publié aux éditions de La Découverte en 2019 et réédité en 2022.
Dans les catégories que vous mentionnez vous ne citez pas les agriculteurs ?
Moi je suis dans les régions où les petites exploitations ont très largement disparu depuis les années 1960. De manière générale, les agriculteurs dans tous les espaces ruraux et les gens qui travaillent en agriculture, ça représente 5 % de la population active. Il y a encore une part importante de représentants politiques et d’élus locaux qui sont dans l’agriculture. et certes, Les agriculteurs sont centraux dans la société rurale, mais numériquement ils sont peu. C’est encore plus vrai dans les régions que j’étudie, de plaines céréalières situées dans le Grand Est.
Là on a des grandes exploitations agricoles de grandes tailles, et ne sont pas forcément pourvoyeuses d’emplois. J’avais quelques jeunes agriculteurs dans ma cohorte d’enquêtés. Les ouvriers agricoles pouvaient naviguer entre des boulots d’ouvriers d’usine et d’exploitation agricole. Parfois ils étaient fidélisés dans la ferme. Ils aspiraient même à reprendre une en gérance. Mais ils étaient éloignés des agriculteurs héritiers familiaux.
Des études ont montré que les enfants de céréaliers, quand ils ne reprennent pas l’exploitation, mènent quasiment les mêmes études que les enfants des cadres. Ceux-là s’en vont. Une partie de la fratrie s’en va en suivant des parcours scolaires assez sélectif. Et de l’autre côté, celui qui hérite de l’exploitation, il a une position relativement dominante. il n’est pas la précarité économique que les jeunes ouvriers ou jeunes femmes employés dans les métiers de service à la personne.
